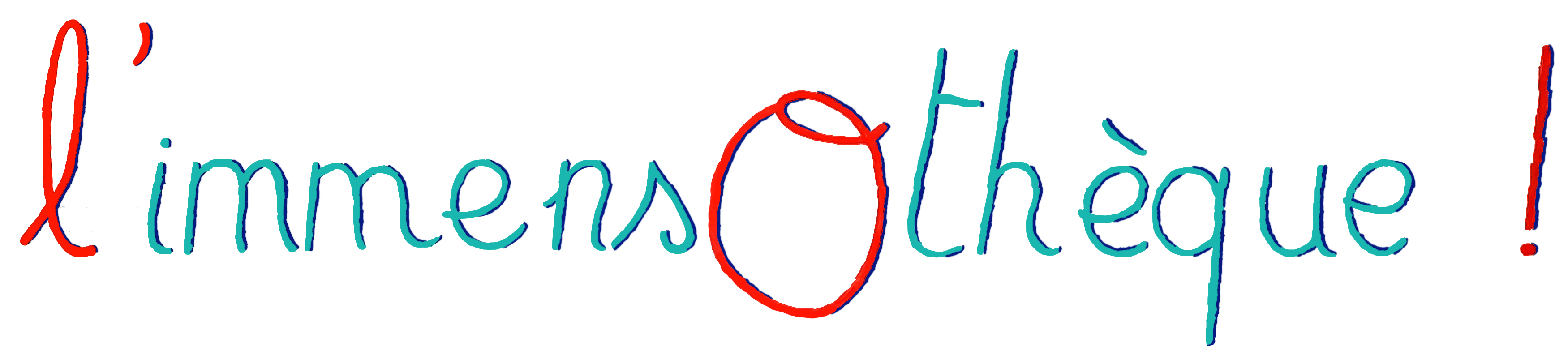Bibliothèque DoucheFLUX Bibliotheek -->
DĂ©tail d'une collection
Documents disponibles dans la collection (4)


 Faire une suggestion Affiner la recherche
Faire une suggestion Affiner la recherche


| Titre : |
Asiles : Ă©tudes sur la condition sociale des malades mentaux et autres reclus |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
Erving Goffman (1922-1982), Auteur ; Liliane et Claude Lainé, Traducteur ; Robert Castel (1933-....), Présentateur |
| Mention d'Ă©dition : |
impr. en 2010 |
| Editeur : |
Paris : Les Éditions de Minuit |
| Année de publication : |
1968 |
| Collection : |
Le sens commun |
| Importance : |
447 p. |
| Format : |
22 cm |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-2-7073-0083-6 |
| Note générale : |
Index pp.439-447 |
| Langues : |
Français (fre) Langues originales : Américain (ame) |
| Tags : |
Sciences humaines et sociales Sociologie Ethnologie Maladies mentales Psychiatrie ContrĂ´le social Institutions sociales |
| Index. décimale : |
362.21 Problèmes et services d'aide sociale - Pour les malades mentaux. Hôpitaux psychiatriques |
| Résumé : |
Avant de devenir professeur de sociologie à l’université de Berkeley, Erving Goffman s’est fait, trois années durant, l’ethnologue scrupuleux des malades mentaux internés dans les hôpitaux psychiatriques. Il présente dans Asiles une interprétation en profondeur de la vie hospitalière qui situe les pratiques thérapeutiques quotidiennes dans leur cadre le plus objectif, celui d’une “ institution totalitaire ”, c’est-à -dire d’un établissement investi, comme la prison ou le camp de concentration par exemple, de la fonction ambiguë de neutraliser ou de réadapter à l’ordre social un type particulièrement inquiétant de déviants.
La tension, et souvent la contradiction, qui existe entre l’exigence thérapeutique et ces impératifs de sécurité et de contrôle social rend compte du mode conflictuel de l’existence asilaire et des malentendus de la vie quotidienne au sein de l’hôpital.
Par-delà les troubles de sa subjectivité, le malade mental est ainsi aliéné au second degré, parce que la maladie est institutionnalisée dans un espace social qui lui impose les déterminations majeures de la servitude. |
|  |
Exemplaires(1)
|
DFX00599
|
DOC 362.21 GOF A |
Livre |
Documentaires
|
Disponible |


| Titre de série : |
La présentation de soi, 1 |
| Titre : |
La mise en scène de la vie quotidienne |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
Erving Goffman (1922-1982), Auteur ; Alain Accardo, Traducteur |
| Editeur : |
Paris : Les Éditions de Minuit |
| Année de publication : |
copyright 1973 |
| Collection : |
Le sens commun |
| Importance : |
251 p. |
| Format : |
22 cm |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-2-7073-0014-0 |
| Langues : |
Français (fre) Langues originales : Américain (ame) |
| Tags : |
Théâtre Relations humaines Sociologie Ethnographie Comportement humain Interaction sociale |
| Index. décimale : |
306 Culture. Institutions sociales. Comportements culturels. Culture populaire, anthropologie sociale et culturelle |
| Résumé : |
Rencontres fortuites, échanges de paroles, de regards, de coups, de mimiques, de mots, actions et réactions, stratégies furtives et rapides, combats ignorés de ceux-là mêmes qui se les livrent avec l’acharnement le plus vif, telle est la matière première qui constitue l’objet, inhabituel, de La Présentation de soi. Pour ordonner ces miettes de vie sociale – résiduelles pour la sociologie canonique qui les néglige – sur lesquelles il concentre l’attention la plus minutieuse, Goffman prend le parti de soumettre à l’épreuve de l’explicitation méthodique une intuition du sens commun : Le monde est un théâtre. Le vocabulaire dramaturgique lui fournit les mots à partir desquels il construit le système des concepts propre à abstraire de la substance des interactions quotidiennes, extérieurement dissemblables, les formes constantes qui leur confèrent stabilité, régularité et sens. Ce faisant, Goffman élabore dès La Présentation de soi, son premier livre, les instruments conceptuels et techniques à partir desquels s’engendre une des œuvres les plus fécondes de la sociologie contemporaine et qui sont peut-être aussi au principe de la constitution des catégories fondamentales d’une nouvelle école de pensée : en rompant avec le positivisme de la sociologie quantitative en sa forme routinisée et en s’accordant pour tâche de réaliser une ethnographie de la vie quotidienne dans nos sociétés, La Présentation de soi peut être tenu pour un des ouvrages qui sont au fondement du courant interactionniste et, plus généralement, de la nouvelle sociologie américaine. |
|  |
Exemplaires(1)
|
DFX00289
|
DOC 306 GOF M |
Livre |
Documentaires
|
Disponible |


| Titre de série : |
Les relations en public, 2 |
| Titre : |
La mise en scène de la vie quotidienne |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
Erving Goffman (1922-1982), Auteur ; Alain Kihm, Traducteur |
| Editeur : |
Paris : Les Éditions de Minuit |
| Année de publication : |
copyright 1973 |
| Collection : |
Le sens commun |
| Importance : |
371 p. |
| Format : |
22 cm |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-2-7073-0063-8 |
| Langues : |
Français (fre) Langues originales : Américain (ame) |
| Tags : |
Relations humaines Dimension sociale Psychologie sociale Interaction sociale Sociologie Individu et société |
| Index. décimale : |
306 Culture. Institutions sociales. Comportements culturels. Culture populaire, anthropologie sociale et culturelle |
| Résumé : |
Cet ouvrage représente l’aboutissement d’une recherche constante dans l’œuvre de Goffman : décrire de façon quasi grammaticale ce qui constitue l’étoffe de la société (de toute société), les rapports entre les gens.
De même que la phrase : “ Auriez-vous du feu ? ” obéit à des règles grammaticales strictes que le locuteur est obligé d’appliquer s’il veut se faire comprendre (et qu’il applique sans y penser) de même les comportements “ interpersonnels ” alors manifestés (façon de s’approcher, mouvements réciproques du regard, forme de l’adresse – “ vous ”, “ monsieur ”, etc.) sont régis par des règles rituelles auxquelles il faut se conformer si l’on ne veut pas choquer.
Il y a pourtant une différence, que Goffman souligne à plusieurs reprises : si les règles linguistiques forment une grammaire, les règles rituelles constituent un “ ordre ”. Et l’ordre social, à la différence d’une grammaire, n’est pas au-delà de l’éthique, car il n’est pas simplement un code fonctionnel, mais il traduit aussi des rapports de domination et de profit. Il s’ensuit que “ mal ” se comporter à une tout autre dimension que “ mal ” parler (au sens de faire des “ fautes ” de syntaxe).
C’est cette dimension proprement politique du comportement inter-individuel qui se découvre progressivement au long des sept articles qui composent le livre et qui se complètent en un cheminement du plus simple au plus complexe, du plus extérieur au plus intériorisé. |
|  |
Exemplaires(1)
|
DFX00288
|
DOC 306 GOF M |
Livre |
Documentaires
|
Disponible |


| Titre : |
Stigmate : les usages sociaux des handicaps |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
Erving Goffman (1922-1982), Auteur ; Alain Kihm, Traducteur |
| Editeur : |
Paris : Les Éditions de Minuit |
| Année de publication : |
1975 |
| Collection : |
Le sens commun num. 43 |
| Importance : |
175 p. |
| Format : |
22 cm |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-2-7073-0079-9 |
| Note générale : |
Notes bibliogr. Index |
| Langues : |
Français (fre) Langues originales : Anglais (eng) |
| Tags : |
psychologie sociale handicap alcoolisme drogues marginaux |
| Index. décimale : |
302 Sciences sociales - Interaction sociale |
| Résumé : |
Il y a le stigmate d’infamie, tel la fleur de lys gravée au fer rouge sur l’épaule des galériens. Il y a les stigmates sacrés qui frappent les mystiques. Il y a les stigmates que laissent la maladie ou l’accident. Il y a les stigmates de l’alcoolisme et ceux qu’inflige l’emploi des drogues. Il y a la peau du noir, l’étoile du juif, les façons de l’homosexuel. Il y a enfin le dossier de police du militant et, plus généralement, ce que l’on sait de quelqu’un qui a fait ou été quelque chose, et “ ces gens-là , vous savez. ”
Le point commun de tout cela ? Marquer une différence et assigner une place : une différence entre ceux qui se disent “ normaux ” et les hommes qui ne le sont pas tout à fait (ou, plus exactement, les anormaux qui ne sont pas tout à fait des hommes) ; une place dans un jeu qui, mené selon les règles, permet aux uns de se sentir à bon compte supérieurs devant le noir, virils devant l’homosexuel, etc., et donne aux autres l’assurance, fragile, qu’à tout le moins on ne les lynchera pas, et aussi l’espoir tranquillisant que, peut-être, un jour, ils passeront de l’autre côté de la barrière. |
|  |
Exemplaires(1)
|
DFX00184
|
DOC 302.0 GOF S |
Livre |
Documentaires
|
Disponible |


 Faire une suggestion Affiner la recherche
Faire une suggestion Affiner la rechercheAsiles / Erving Goffman
La présentation de soi, 1. La mise en scène de la vie quotidienne / Erving Goffman
Les relations en public, 2. La mise en scène de la vie quotidienne / Erving Goffman
Stigmate / Erving Goffman