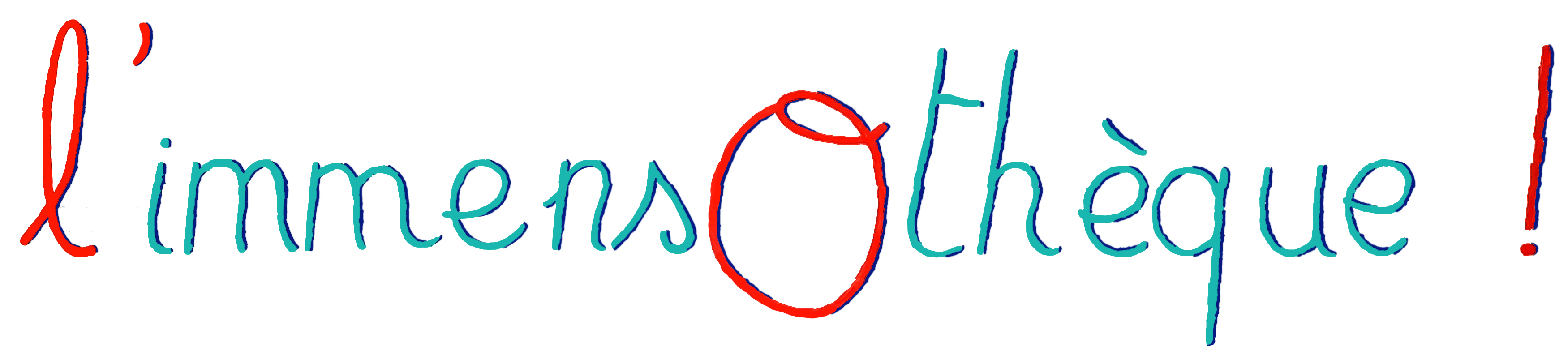Bibliothèque DoucheFLUX Bibliotheek -->
Résultat de la recherche
4 recherche sur le tag 'Géographie'



 Affiner la recherche Générer le flux rss de la recherche
Partager le résultat de cette recherche Faire une suggestion
Affiner la recherche Générer le flux rss de la recherche
Partager le résultat de cette recherche Faire une suggestion
Titre : Cartographie radicale : explorations Type de document : texte imprimé Auteurs : Nepthys Zwer (1962-....), Cartographe ; Philippe Rekacewicz (1960-....), Cartographe Editeur : Paris : La Découverte Année de publication : 2021 Importance : 295 p. Présentation : ill. en coul. Format : 28 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-37368-053-9 Note générale : Prix Georges Erhard de la Société de géographie, 2022
Bibliogr. p. 270-278. Filmogr., sitogr. p. 279Langues : Français (fre) Tags : Atlas Résistance politique Radicalisme Géopolitique Relations internationales Ethnographie Critique et interprétation Géographie Index. décimale : 912 Représentations graphiques de la surface terrestre et des mondes extraterrestres. Atlas, cartes et plans Résumé : Il est des cartes qui disent non. Des cartes radicales, qui dévoilent et dénoncent, qui protestent. Pour comprendre ces cartes rebelles, leur fonctionnement, leurs forces, leurs possibilités, ce livre entreprend un voyage d'exploration au cœur de la création cartographique. Que se passe-t-il exactement quand nous élaborons une carte, qu'elle soit radicale, expérimentale (on parle aussi de cartographie critique ou de contre-cartographie) ou conventionnelle ? Quelles intentions président à sa fabrication et à sa mise en œuvre ? La première fonction des cartes est de nous aider à nous repérer dans l'espace et à nous déplacer d'un point à un autre. Elles permettent aux bateaux de naviguer et aux avions de voler. Avec des cartes, on fait la guerre, puis éventuellement la paix. Elles sont aussi de formidables machines à rêves, qui façonnent notre image du monde, en fixent la mémoire et finissent par fabriquer notre réalité. Qu'est-ce qui motive cet acte très particulier de mise en forme symbolique du monde, de Strabon à l'anarchiste Élisée Reclus, de la bénédictine Hildegard von Bingen à l'explorateur Alexander von Humboldt, des portulans à la carte d'état-major ? Quelle part de fantaisie créatrice, quelle part de fantasme faustien d'une possible maîtrise de notre environnement, quelle part de sincérité scientifique sont-elles à l’œuvre ? Entre l'émergence de la cartographie thématique audacieuse de l'ingénieur Charles-Joseph Minard, ou celle des designers d'information Otto et Marie Neurath, et l'approche sémiologique conceptuelle de Jacques Bertin, se situe un point de rupture avec les conventions de la représentation cartographique. Un point libérateur qui a ouvert le champ de l'expérimentation et rendu possible la démocratisation des cartes. Autour des années 1900, le sociologue W. E. B. du Bois et son équipe inventaient de nouvelles façons graphiques de représenter des données statistiques sur la situation des personnes noires aux États-Unis. Quelque soixante ans plus tard, c'était pour dénoncer le même racisme culturel et économique qu'un petit institut de géographie de Détroit, animé par William Bunge et Gwendolyn Warren, donnait ses contours à ce qui deviendra la géographie radicale : une géographie engagée. Alors, le rapport à l'objet carte change. S'opère une prise de conscience quant à son usage et à ses possibilités. La cartographie radicale va spatialiser les données économiques et sociales, produire des cartes délibérément politiques qui montrent et dénoncent les situations d'inégalités de vie et de droits, les compromissions politico-économiques, les accaparements de terres, la destruction des milieux par l'agro-industrie, la pollution de la planète et tout ce qui hypothèque, d'une façon ou d'une autre, le bonheur et l'avenir de l'humanité. Les cartes, qui jouent traditionnellement le jeu du pouvoir, se font outils de la contestation et instruments d'émancipation politique et sociale quand la société civile se les approprie. Politique, art et science entrent alors en dialogue permanent pour proposer une image non convenue et libre du monde. Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Section Disponibilité DFX00722 DOC 912 ZWE C Livre Documentaires Disponible L'Avènement du Monde / Michel Lussault
Titre : L'Avènement du Monde : Essai sur l'habitation humaine de la Terre Type de document : texte imprimé Auteurs : Michel Lussault, Auteur Editeur : Paris : Éditions du Seuil Année de publication : 2013 Importance : 296 P. Format : 21 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-02-096664-1 Langues : Français (fre) Tags : Urbanisme Géographie Villes Habitat Mondialisation Index. décimale : 304.23 Facteurs géographiques, spatiaux, temporels influençant le comportement social Résumé : En un demi-siècle, le monde est devenu le Monde.
Avec cette majuscule, il ne s’agit pas de dire que le monde a changé sous l’effet de la mondialisation, mais d’affirmer qu’il est véritablement advenu, subvertissant les ordres anciens (empires, États, villes, etc.) et les catégories intellectuelles qui nous permettaient de les penser. La mondialisation bouleverse tout et construit de nouveaux cadres de vie et d’organisation des sociétés humaines. Les mutations sont de tous ordres et l’on peine encore à stabiliser les analyses, sans doute parce que nos outils conceptuels, forgés aux XIXe et XXe siècles, sont désormais largement inadaptés.
Ce livre ambitieux souhaite sortir de cette impasse et cerner quelques-unes des forces instituantes et imaginantes du Monde, et en particulier l’urbain, parce que le Monde se manifeste d’abord et surtout par de nouvelles manières d’habiter la Terre. Le Monde est une nouvelle organisation spatiale des réalités sociales, produisant des imaginaires inédits et contribuant à la création et à la diffusion d’images qui en elles-mêmes expriment la mondialité. Car le Monde nous traverse de part en part en permanence : nous en sommes chacun tout à la fois un produit, un jouet, un vecteur, un acteur.
À partir de là, comment imaginer une « politique du Monde » quand on sait que l’avenir dépendra de notre capacité commune à garantir son habitabilité pour les décennies qui viennent ?Exemplaires (2)
Code-barres Cote Support Section Disponibilité DFX00200 DOC 304.23 LUS A Livre Documentaires Exclu du prêt DFX00488 DOC 304.23 LUS A Livre Documentaires Disponible Le capitalisme contre le droit à la ville / David W. Harvey
Titre : Le capitalisme contre le droit à la ville : néolibéralisme, urbanisation, résistances Type de document : texte imprimé Auteurs : David W. Harvey (1935-....), Auteur ; Cyril Le Roy, Traducteur Editeur : Paris : Amsterdam Année de publication : 2011 Importance : 93 p. Format : 19 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-35480-095-6 Note générale : Bibliogr. Langues : Français (fre) Langues originales : Américain (ame) Tags : Géographie Anthropologie Urbanisme Lutte Dimension sociale Relations humaines Villes Lutte de classes Capitalisme Néolibéralisme Résistance politique Index. décimale : 307.76 Communautés -- Urbaines (types de communautés) Résumé : Que peut bien vouloir dire « droit à la ville » ? Cette interrogation est indissociable d’une multitude d’autres questions. Quelle ville voulons-nous ? Quel genre de personnes voulons-nous être ? À quelles relations sociales aspirons-nous ? Quelle vie quotidienne trouvons-nous désirable ? Quelles valeurs esthétiques défendons-nous ? Quel rapport à la nature souhaitons-nous promouvoir ? Quelles technologies jugeons-nous appropriées ? Le droit à la ville ne se réduit ainsi pas à un droit d’accès individuel aux ressources incarnées par la ville : c’est un droit à nous changer nous-mêmes en changeant la ville de façon à la rendre plus conforme à nos désirs les plus fondamentaux. C’est aussi un droit plus collectif qu’individuel, puisque, pour changer la ville, il faut nécessairement exercer un pouvoir collectif sur les processus d’urbanisation. Il importe dans cette perspective de décrire et d’analyser la manière dont, au cours de l’histoire, nous avons été façonnés et refaçonnés par un processus d’urbanisation toujours plus effréné et étendu, animé par de puissantes forces sociales et ponctué de violentes phases de restructurations urbaines par « destruction créative », ainsi que par les résistances et les révoltes que ces restructurations suscitaient. On saisira alors toute l’actualité de la thèse d’Henri Lefebvre : le processus urbain étant essentiel à la survie du capitalisme, le droit à la ville, autrement dit le contrôle collectif de l’emploi des surplus dans les processus d’urbanisation, doit devenir l’un des principaux points de focalisation des luttes politiques et de la lutte des classes. Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Section Disponibilité DFX00517 DOC 307.76 HAR C Livre Documentaires Disponible
Titre : Habiter Bruxelles sans abri Type de document : texte imprimé Auteurs : Elisabetta Rosa, Auteur Editeur : Marseille : Éditions Imbernon Année de publication : 2022 Collection : Collection Habiter Importance : 184 p. Présentation : ill. en coul. photogr. cartes Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-919230-35-8 Langues : Français (fre) Tags : Géographie Ethnographie Sans-chez-soi Urbanisme Dimension sociale Pauvres en milieu urbain Femmes Habitat Espace public Architecture Dispositif "anti-SDF" Quartiers de Bruxelles Bruxelles (Belgique) Index. décimale : 711.4 Aménagement du territoire urbain - Aménagement au plan communal Résumé : Comment les personnes sans-abri habitent-elles la ville ? Quel rapport à l’espace construisent-elles ? De quoi est faite la ville qu’elles habitent ? La présence des personnes sans-abri dans les espaces publics de la ville est souvent perçue comme celle d’une altérité indépassable qui dérange, met mal à l’aise, fait peur.
Issue de cinq années de recherches et d’enquêtes ethnographiques menées à Bruxelles, la réflexion développée dans ce volume interroge ces représentations de manière critique et propose une compréhension différente des personnes sans-abri et des espaces qu’elles pratiquent. Pour ce faire, la question du sans-abrisme est abordée au prisme de l’habiter, en prenant en considération la quête de ces personnes d’espaces habitables. Comment une telle approche peut-elle contribuer à la reconnaissance des personnes sans-abri en tant qu’habitants légitimes de la ville ? Comment une telle reconnaissance peut-elle devenir une opportunité pour repenser le projet urbain, l’habitabilité de la ville et les possibilités de coexistence qu’il vise à concrétiser ? Les cinq parties qui composent le volume explorent la relation entre l’habiter « sans-abri » - avec une attention spécifique portée aux femmes – et les transformations de l’espace urbain. Ce faisant, « le sans-abrisme » perd ses contours de phénomène unique et uniforme : des géographies multiples se révèlent, faites d’une pluralité de modes d’occupation des espaces publics, d’une hétérogénéité d’espaces investis, d’une diversité de personnes concernées. Chacune d’entre elles construit et reconstruit constamment le rapport à la ville qui lui est propre, et performe ainsi sa quête d’espaces habitables.Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Section Disponibilité DFX00672 DOC 711.4 ROS H Livre Documentaires Disponible